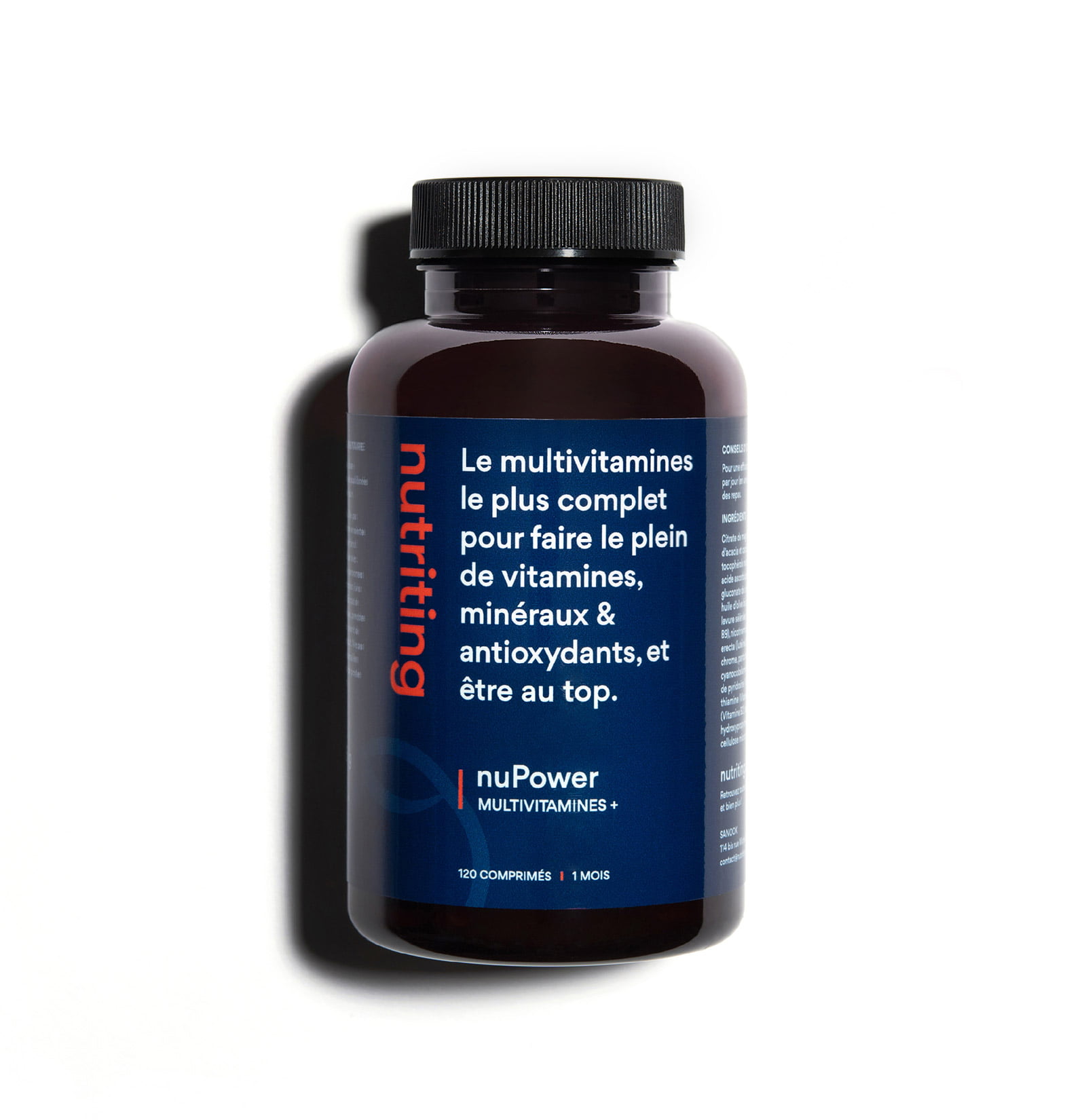Accueil > Nos conseils & astuces > Charcuterie et viande rouge sont-elles cancérigènes ?
Charcuterie et viande rouge sont-elles cancérigènes ?
Une antenne de l’OMS, l’IARC, a émis une communication concernant le classement de la consommation de viande rouge comme “probablement cancérigène pour l’homme” (Groupe 2A) et de la consommation de viande transformée comme “cancérigène pour l’homme” (Groupe 1). Une fois l’effervescence retombée, nous allons essayer d’examiner les éléments avancés par l’IARC pour voir s’il est possible d’en retirer des recommandations en termes de consommation de viande pour la santé, en particulier de viande rouge et de charcuterie.
Par Laurent Buhler, Diététicien-nutritionniste et DU de Lecture des Essais Cliniques
Publié le 3 mars 2023, mis à jour le 17 octobre 2023

Impossible d’y avoir échappé, les gros titres ont fait la une des médias français et internationaux :
- Pour Le Parisien : “OMS : la charcuterie cancérogène, la viande rouge aussi « probablement »
- Pour Libération : “La charcuterie et les viandes accusées de favoriser le cancer”
- Pour Le Monde : “La viande rouge est « probablement » cancérogène”
- Pour Le Figaro : “La charcuterie est cancérogène, la viande rouge « probablement » aussi selon l’OMS”
Charcuterie, viande rouge et cancer : quelques précisions sur le rapport de l’IARC
L’IARC est l’International Agency for Research on Cancer ou Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC en français).
Dans un premier temps, il convient de préciser un certain nombre de points.
Il ne s’agit pas d’une “nouvelle” étude
Contrairement à ce qui a été annoncé par plusieurs médias, la communication de l’IARC ne concerne pas une « nouvelle étude ». Le “Groupe de Travail” (ainsi dénommé dans les documents de l’IARC) a en réalité examiné la littérature scientifique déjà existante sur le sujet.
Ensuite, nous ne disposons pour l’instant que d’un pré-rapport, constitué par un article publié dans la revue The Lancet1. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les vrais résultats du travail mené par l’IARC sont en effet “à paraître” dans le volume 114 des monographies publiées par cet organisme.
Le déferlement médiatique a donc eu lieu alors qu’il n’est même pas possible d’examiner en détail les arguments du Groupe de Travail. On peut même se demander si certains médias ne se sont pas contentés du simple communiqué de presse, ce qui expliquerait les approximations apparues dans la façon dont il a été rendu compte de cette communication.
Une communication maladroite
On peut également s’étonner qu’un organisme de niveau international puisse émettre une communication aussi maladroitement rédigée, dans un domaine scientifique où on attend justement de la clarté, de la précision et de l’exactitude.
Heureusement, la lecture du pré-rapport publié dans The Lancet offre déjà la possibilité de prendre une certaine distance par rapport aux annonces faites dans la presse.
Une rédaction décousue
De plus, la rédaction en est plutôt décousue, ce qui permettra, par une simple réorganisation du texte, d’amener encore un peu plus de clarification.
Alors que les informations concernant viande rouge et viande transformée sont entremêlées au risque d’apporter une confusion supplémentaire sur un sujet déjà assez complexe, nous vous proposons donc de bien traiter ces deux catégories séparément.
Vous connaissez nos compléments alimentaires ?
Des formulations basées 100% sur la Science, les meilleures formes pour chaque ingrédient, et des dosages 100% physiologiques. Pour prendre soin de votre santé et être au top.
Charcuterie, viande rouge et cancer : la méthodologie du rapport de l’IARC
Le Groupe de Travail de l’IARC a évalué plus de 800 études épidémiologiques qui ont examiné l’association entre cancer et viande rouge ou viande transformée dans de nombreux pays. Pour l’évaluation, le poids le plus important a été donné aux études prospectives de cohortes. Des études cas-témoins ont également été utilisées pour fournir des éléments complémentaires. Parmi ces études ont été retenues celles qui considéraient séparément viande rouge et viande transformée, proposaient des données quantitatives alimentaires obtenues à partir de questionnaires validés, offraient une taille d’échantillon suffisamment large et contrôlaient les facteurs de confusion pour les types de cancer.
Le rapport s’appuie principalement sur de l’observation
On apprend donc que ce rapport s’appuie en premier lieu sur des études épidémiologiques, c’est-à-dire sur de l’observation.
Ainsi que nous l’avons expliqué à plusieurs reprises dans nos articles, l’épidémiologie permet d’établir une association entre deux variables : si je m’intéresse à la variable A, est-ce que la variable B évolue dans le même sens ? (ou en sens contraire ?)
En revanche, l’épidémiologie ne permet pas d’établir un lien de causalité entre deux variables : on ne peut pas dire si A cause B ou si B cause A ou si une autre variable, C, cause A et B.
Un petit exemple pour mieux comprendre
Pour mieux comprendre, utilisons un exemple certes grossier mais parlant : au mois de novembre, on s’aperçoit que nos compatriotes ressortent vestes et pulls des placards (variable A) et que les arbres perdent leurs feuilles (variable B). Est-ce le fait de passer une veste qui fait tomber les feuilles de l’arbre ?
Pour tester notre observation, nous allons procéder, ainsi que cela est fait dans les études épidémiologiques, à un contrôle des facteurs de confusion. Par exemple, nous allons regarder ce qui se passe selon que les groupes étudiés portent par ailleurs des jupes ou des pantalons.
Résultat : l’observation a l’air solide car le fait de porter une jupe ou un pantalon ne modifie pas la force de l’association, et c’est bien le fait d’enfiler une veste ou un pull qui est lié à la chute des feuilles.
Enfin pour valider nos travaux, nous allons poser une hypothèse que nous tenterons de vérifier par une expérience : lorsqu’on enfile une veste, cela crée un souffle d’air qui fait tomber les feuilles. Rassemblons donc quelques feuilles mortes dans notre laboratoire et agitons énergiquement une veste : une partie des feuilles s’envolent.
Au total, nous avons donc une observation consistante, pour laquelle nous avons corrigé les facteurs de confusion, et que nous avons validé par une expérience en laboratoire. Nous pouvons donc rédiger une communication pour annoncer que porter des vestes et des pulls entraîne la chute des feuilles.
Bien sûr, cet exemple est caricatural, mais il a le mérite d’illustrer les écueils qui attendent les épidémiologistes lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact d’un facteur donné sur la santé.
Le recours aux études d’intervention est difficile en nutrition
La solution idéale pour contourner ce type de problème est le recours aux études dites « d’intervention », qui sont les seules qui permettent d’établir clairement un lien de causalité.
Malheureusement, dans le domaine de la nutrition, ces études sont extrêmement difficiles à réaliser, tant pour des impératifs de coûts que d’organisation.
C’est la raison pour laquelle la plupart des recommandations nutritionnelles s’appuient sur l’épidémiologie. Si les évaluations sont menées avec rigueur et que les associations sont fortes, cela peut être légitime. Après tout, c’est grâce à l’épidémiologie que l’on a pu mettre en évidence les liens entre cancer du poumon et consommation de tabac.
La question des questionnaires validés
Une remarque également sur la notion de “questionnaires validés” : plusieurs études ont mis en évidence le manque de fiabilité des questionnaires alimentaires, d’une part parce que les sujets interrogés ne se souviennent pas avec exactitude du contenu de leurs repas, et d’autre part parce qu’ils ont tendance à tricher (même inconsciemment), en gonflant la consommation de produits perçus comme sains et en cachant celle des aliments déconseillés.
Pour donner une idée de ce à quoi ressemble un de ces questionnaires, voici celui d’une des plus importantes études de cohorte européenne de ces dernières années : l’étude EPIC.
Charcuterie, viande rouge et cancer : les conclusions du rapport de l’IARC
La conclusion du rapport de l’IARC sur la charcuterie et le risque cancérigène
Débutons avec la conclusion émise par le Groupe de Travail, dans la partie du pré-rapport qui est consacrée à la charcuterie et aux viandes transformées :
Globalement, le groupe de travail a classé la consommation de viande transformée comme « cancérigène pour l’homme » (Groupe 1) en s’appuyant sur des preuves suffisantes concernant le cancer colorectal. De plus, une association positive a été trouvée entre la consommation de viande transformée et le cancer de l’estomac.
La conclusion du rapport de l’IARC sur la viande rouge et le risque cancérigène
Comme nous l’avons fait juste au-dessus, nous allons également partir de la conclusion émise par le Groupe de Travail :
Le Groupe de Travail a classé la consommation de viande rouge comme «probablement cancérigène pour l’homme» (Groupe 2A). Pour faire cette évaluation, le Groupe de Travail a pris en considération toutes les données pertinentes, ce qui inclue les données épidémiologiques substantielles montrant une association positive entre la consommation de viande rouge et le cancer colorectal ainsi que des preuves mécanistiques fortes. La consommation de viande rouge était également associée de manière positive aux cancers du pancréas et de la prostate.
Le Groupe de Travail annonce donc des données épidémiologiques substantielles et des preuves mécanistiques fortes. Voyons maintenant sur quoi reposent ces arguments.
La viande rouge contient des protéines de haute valeur biologique et des micronutriments importants tels que les vitamines du groupe B, du fer, du fer héminique et du zinc.
Dans ce préambule, le Groupe de Travail souligne les qualités nutritionnelles de la viande rouge, un ensemble de qualités dont il conviendra effectivement de tenir compte lorsqu’on cherchera à établir la balance bénéfice/risque associée à sa consommation.
La consommation moyenne de viande rouge est d’environ 50 à 100 g par personne et par jour, les consommations élevées pouvant dépasser 200 g.
Pas de commentaire particulier. Gardons tout de même en mémoire ces différents niveaux de consommation pour apprécier par la suite les quantités rapportées ou utilisées dans les études.
Charcuterie et risque cancérigène : notre analyse du rapport de l’IARC
Pour ceux que cela intéresse, l’intégralité de notre analyse est à retrouver dans cet article complet.
Charcuterie et cancer colorectal : un lien qui dépend du contexte
Au terme de cette analyse, il n’est évidemment pas question de suggérer que le risque est nul.
Ce que les études “mécanistiques” menées sur les rongeurs et les humains semblent indiquer, c’est que le lien entre cancer colorectal et viande transformée dépend du contexte.
En présence d’un initiateur cancérigène et d’une alimentation carencée en calcium et en vitamine E, la consommation de charcuterie et viande transformée pourrait modifier certains marqueurs associés au risque de cancer colorectal.
Ce type de contexte peut exister chez des individus qui sont exposés à des cancérogènes connus (tabac, alcool), et dont l’alimentation est peu équilibrée.
Charcuterie et cancer colorectal : une formulation plus judicieuse ?
Peut-être aurait-il donc été plus judicieux d’indiquer que : les styles de vie incluant habituellement une consommation régulière de charcuterie et de viande transformée sont associés à une augmentation du risque de cancer colorectal.
On peut en effet raisonnablement penser qu’un individu qui boit, fume, est en surpoids, n’a pas d’activité physique, mange peu de fruits et légumes mais beaucoup de frites et de barres chocolatées pour accompagner des plats tout prêts à base de charcuterie et de viande transformée, aura plus de risque de développer un cancer colorectal que son voisin qui ne boit pas (ou peu), ne fume pas, n’est pas en surpoids, fait du sport régulièrement, a une alimentation équilibrée, passe du temps en cuisine et s’accorde occasionnellement quelques tranches de saucisse sèche d’Auvergne ou de jambon de Bayonne, accompagnées d’une belle salade assaisonnée d’huile d’olive.
Vous connaissez la spiruline ?
Il s’agit d’une micro-algue qui est souvent présentée comme un « super-aliment ». Vrai ou pas, la spiruline présente de nombreux bienfaits, en particulier pour les végétariens puisqu’elle est riche en protéines complètes et avec une densité nutritionnelle très forte.
Viande rouge et risque cancérigène : notre analyse du rapport de l’IARC
De la même manière que pour la charcuterie, vous trouverez l’intégralité de notre analyse dans cet article complet.
Au terme de cette excursion au pays de l’épidémiologie et des études mécanistiques, que conclure ?
Viande rouge et cancer : l’importance des notions de dose et de contexte
Si l’on s’en tient aux faits établis, nous avons deux résultats d’études cliniques, plutôt convaincants, qui indiquent qu’au-delà de 300 g par jour et en l’absence d’amidon ou de fibres, une consommation élevée de viande rouge favorise l’apparition de molécules mutagènes capables de s’incorporer à l’ADN par substitution à certaines bases.
Heureusement, nous possédons, dans notre “quincaillerie génétique” des outils de correction et de réparation, qui peuvent remettre à neuf ou éliminer une partie des morceaux de ruban défectueux lors de la transcription de l’ADN en protéines. Donc il se peut que notre organisme soit en mesure de “gérer” une certaine quantité de molécules mutagènes.
Les notions de dose et de contexte prennent tout leur sens ici puisque sans doute, au-delà d’une certaine dose ou dans un certain contexte (vieillissement, faiblesse immunitaire, carences alimentaires), nos capacités réparatrices peuvent se trouver dépassées et ne plus être en mesure de bloquer l’expression de protéines défectueuses.
Concrètement, on peut donc considérer qu’avoir une alimentation exclusivement composée de grandes quantités de viande rouge (plus de 300 g par jour, tous les jours) n’est peut-être pas une très bonne idée (même si l’on n’a pas de preuve directe qu’une telle pratique augmente significativement l’apparition de cancers colorectaux).
Viande rouge et cancer : prendre un peu de recul
Cependant, si on prend un peu de recul par rapport à l’approche de type “réductionniste” des deux études cliniques citées plus haut, on doit considérer deux choses :
L’organisme abrite une multitude de réactions physico-chimiques
D’une part, l’organisme abrite une multitude de réactions physico-chimiques qui assurent notre maintien en vie à court, moyen et plus long terme dans le cadre de l’homéostasie. Les études n’examinent qu’un type de réaction parmi cette multitude.
Or comme le souligne le pré-rapport de l’IARC (voir plus haut) :
La viande rouge contient des protéines de haute valeur biologique et des micronutriments importants tels que les vitamines du groupe B, du fer, du fer héminique et du zinc.
On peut donc considérer qu’il est possible de consommer une certaine quantité de viande, qui nous apportera des nutriments nécessaires à notre équilibre, sans pour autant être préjudiciable à notre santé.
On ne mange jamais uniquement de la viande
Et d’autre part, dans la vie réelle il est rare de suivre un régime alimentaire mono-produit.
Or là aussi, dans les références même du pré-rapport de l’IARC, on trouve des études qui suggèrent que certains aliments (comme par exemple les légumes verts, les fruits secs, les légumineuses, certaines céréales, les aliments riches en calcium) sont à même de bloquer ou de contrer les effets éventuellement délétères d’une consommation excessive de viande rouge.
Viande rouge et cancer : le risque zéro n’existe pas
Pour tous les autres aspects “mécanistiques” liés à la viande rouge, il est très difficile de conclure. Par exemple, les composés aromatiques sont présents dans de nombreux aliments, en particulier dans ceux identifiés comme protecteurs vis-à-vis du risque d’adénome colorectal.
De même, la présence de fer apparaît soit comme n’étant pas associée à la présence d’adénomes, soit comme facteur de réduction du risque.
Au bout du compte, cela suggère que le “risque zéro” n’existe pas : tout bénéfice vient avec sa contrepartie, et à trop se focaliser sur un paramètre ou l’autre, on risque de rater l’essentiel, à savoir l’intérêt probable qu’il y a à diversifier son alimentation en variant les sources d’apports nutritionnels.
Viande rouge et cancer : quelques pistes de réflexion
Avant de clôturer définitivement cette analyse sur quelques conseils très concrets, voici quelques pistes de réflexion à laisser décanter, sur la base de 3 publications récentes :
Une grande méta-analyse de novembre 2015
D’abord, une grande méta-analyse publiée en novembre 201518, qui n’a donc pas pu être intégrée dans le pré-rapport de l’IARC, conclut que :
Au mieux, les données épidémiologiques concernant le rapport entre consommation de viande rouge et cancer colorectal : A – établissent des associations faibles ; B – sont hétérogènes et incapables de faire la distinction avec d’autres facteurs alimentaires ou de style de vie ; C – ne parviennent pas à déterminer comment fonctionne la relation dose-dépendante ; D – et voient leur niveau de preuve diminuer à mesure que les études s’accumulent.
Une étude réalisée au Royaume-Uni
Ensuite, une étude réalisée au Royaume-Uni avec un suivi d’environ 30 ans, dont les résultats viennent d’être annoncés19, suggère que lorsqu’on considère la mortalité toutes causes confondues, il n’y a pas de différences entre mangeurs de viande et végétariens/végétaliens.
Paradoxalement, cela est d’autant plus intéressant que dans cette étude, les mangeurs de viande étaient en moyenne plus vieux, plus gros consommateurs d’alcool et plus sédentaires que les végétariens/végétaliens.
Un article de réflexion de juillet 2015
Enfin, un article de réflexion daté de juillet 2015 et largement documenté20 explique à quel point les questionnaires alimentaires sur lesquels reposent toutes les études épidémiologiques sont peu fiables et par conséquent, à quel point il est hasardeux de fonder des recommandations nutritionnelles en s’appuyant sur ces études.
L’épidémiologie a rendu et rendra encore de nombreux services lorsqu’elle teste des associations en s’appuyant sur des données objectives (par exemple : paramètres sanguins ou appareils de mesure).
En revanche, elle n’est tout simplement pas adaptée à l’évaluation de mesures subjectives (par exemple : questionnaires alimentaires ou fréquence rapportée des rapports sexuels).
Nos conseils pour consommer de la viande rouge sans risque
Comme promis, voici quelques conseils concrets pour profiter au mieux des bienfaits de la viande rouge, si vous choisissez d’en consommer :
Varier ses sources de protéines
Il n’est sans doute pas souhaitable de consommer de la viande rouge tous les jours, à tous les repas.
Dans la mesure du possible, il vaut mieux varier ses sources d’apports protéiques : viande blanche, poisson, crustacés, œufs, produits laitiers, viande rouge, et/ou tofu et seitan, et/ou encore, des combinaisons de protéines végétales complémentaires (riz / lentilles, riz / haricots, blé / pois chiche, maïs / haricots noirs, etc.).
Eviter les cuissons trop agressives ou utiliser des matières grasses ou des marinades
Les cuissons en contact direct avec la source de chaleur (grill à sec, barbecue) favorisent la formation de composés aromatiques potentiellement cancérigènes.
Il est préférable d’utiliser des matières grasses et/ou marinades pour faire “écran” entre la flamme ou le métal et l’aliment (cela vaut également pour les viandes blanches ou le poisson, et même les légumes).
Si certaines parties sont malgré tout carbonisées (cuisson trop longue ou trop proche des braises), il suffit de les éliminer.
De même, la pratique qui consiste à récupérer les sucs de cuisson pour en faire une sauce (“déglacer” en jargon de cuisine) doit s’envisager avec parcimonie : c’est en effet dans ces résidus de cuisson que se concentrent les composés aromatiques. Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez consulter nos astuces pour un barbecue sain.
Varier son alimentation
Un régime carnivore pur à base de viande rouge majore peut-être le risque de cancer colorectal.
Il ne faut donc pas hésiter à varier son alimentation, en consommant régulièrement des légumes crus et cuits, des fruits, des graines oléagineuses, des féculents, des épices et herbes aromatiques, en fonction des goûts et tolérances de chacun.
Finalement, les arguments présentés dans le rapport de l’IARC peinent à prouver l’existence d’un risque réel associé à la consommation de viande rouge dans le cadre d’une alimentation équilibrée, contrairement à la présentation très anxiogène qui en a été faite dans les médias.
Il est bien évident qu’il n’existe aucune obligation à manger de la viande rouge, ni même de la viande tout court, et qu’un régime végétarien bien construit peut apporter tous les nutriments nécessaires à une santé optimale.
Néanmoins, si vous choisissez d’en consommer, voici nos conseils pour profiter au mieux des bienfaits de la viande rouge :
- Variez vos sources de protéines (viande blanche, poisson, crustacés, œufs, produits laitiers, viande rouge, tofu et seitan, combinaisons de protéines végétales complémentaires) ;
- Evitez les cuissons trop agressives ou utiliser des matières grasses ou des marinades ;
- Variez votre alimentation, en rajoutant un maximum de légumes crus et cuits, fruits, graines oléagineuses, féculents, épices et herbes aromatiques, etc.
Vous avez aimé cet article ?
Vous aimerez aussi nos compléments alimentaires ! Ils ont été élaborés avec la même passion et la même rigueur scientifique. Un petit tour dans notre nuShop, c’est par ici.
FAQ : Charcuterie, viande rouge et cancer
La charcuterie est-elle cancérigène ?
Les études menées sur les rongeurs et les humains semblent indiquer que le lien entre charcuterie et cancer colorectal dépend du contexte.
En présence d’un initiateur cancérigène et d’une alimentation carencée en calcium et en vitamine E, la consommation de charcuterie et viande transformée pourrait modifier certains marqueurs associés au risque de cancer colorectal.
Ce type de contexte peut exister chez des individus qui sont exposés à des cancérogènes connus (tabac, alcool), et dont l’alimentation est peu équilibrée.
La viande rouge est-elle cancérigène ?
Le fameux rapport de l’IARC (antenne de l’OMS), n’a pas réussi à prouver l’existence d’un risque réel associé à la consommation de viande rouge dans le cadre d’une alimentation équilibrée.
Au contraire, la viande rouge pourrait même avoir des bienfaits pour la santé, si tant est qu’elle soit consommée modérément et intelligemment.
Comment profiter des bienfaits de la viande rouge ?
Si vous choisissez de consommer de la viande rouge, voici nos conseils pour profiter au mieux de ses bienfaits :
- Variez vos sources de protéines (viande blanche, poisson, crustacés, œufs, produits laitiers, viande rouge, tofu et seitan, combinaisons de protéines végétales complémentaires) ;
- Evitez les cuissons trop agressives ou utiliser des matières grasses ou des marinades ;
- Variez votre alimentation, en rajoutant un maximum de légumes crus et cuits, fruits, graines oléagineuses, féculents, épices et herbes aromatiques, etc.
- Bouvard et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol. 2015 Oct 23. pii: S1470-2045(15)00444-1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26514947
- Chan et al. Red and processed meat and colorectal cancer incidence: meta-analysis of prospective studies. PLoS One. 2011;6(6):e20456.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674008 - Aune et al. Red and processed meat intake and risk of colorectal adenomas: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Cancer Causes Control. 2013 Apr;24(4):611-27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23380943
- Wu et al. Meat mutagens and risk of distal colon adenoma in a cohort of U.S. men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006 Jun;15(6):1120-5.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16775169 - Tantamango et al. Foods and food groups associated with the incidence of colorectal polyps: the Adventist Health Study. Nutr Cancer. 2011;63(4):565-72.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21547850 - Ferrucci et al. Meat consumption and the risk of incident distal colon and rectal adenoma. Br J Cancer. 2012 Jan 31;106(3):608-16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22166801 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3281548/table/tbl2/
- Chan et al. Hemochromatosis gene mutations, body iron stores, dietary iron, and risk of colorectal adenoma in women. J Natl Cancer Inst. 2005 Jun 15;97(12):917-26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15956653
- Alaejos et al. Factors that affect the content of heterocyclic aromatic amines in foods. Comp Rev Food Sci Food Safe 2011;10: 52–108. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-4337.2010.00141.x/abstract
- Alaejos et al. Exposure to heterocyclic aromatic amines from the consumption of cooked red meat and its effect on human cancer risk: a review. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2008 Jan;25(1):2-24.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952757 - Alomirah et al. Concentrations and dietary exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from grilled and smoked foods. Food Control 2011;22: 2028–35. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713511002258
- Tikka : https://en.wikipedia.org/wiki/Tikka_(food)
- Shish taouk : https://en.wikipedia.org/wiki/Shish_taouk
- Shawarma : https://en.wikipedia.org/wiki/Shawarma
- EFSA. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain. http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/724
- Le Leu et al. Butyrylated starch intake can prevent red meat-induced O6-methyl-2-deoxyguanosine adducts in human rectal tissue: a randomised clinical trial. Br J Nutr. 2015 Jul;114(2):220-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26084032
- Lewin et al. Red meat enhances the colonic formation of the DNA adduct O6-carboxymethyl guanine: implications for colorectal cancer risk. Cancer Res. 2006 Feb 1;66(3):1859-65. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16452248
- Bingham et al. Does increased endogenous formation of N-nitroso compounds in the human colon explain the association between red meat and colon cancer? Carcinogenesis. 1996 Mar;17(3):515-23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8631138
- Alexander et al. Red Meat and Colorectal Cancer: A Quantitative Update on the State of the Epidemiologic Science. J Am Coll Nutr. 2015;34(6):521-43.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25941850 - Appleby et al. Mortality in vegetarians and comparable nonvegetarians in the United Kingdom. Am J Clin Nutr. 2016 Jan;103(1):218-30.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26657045 - Archer et al. The Inadmissibility of What We Eat in America and NHANES Dietary Data in Nutrition and Obesity Research and the Scientific Formulation of National Dietary Guidelines. Mayo Clin Proc. 2015 Jul;90(7):911-26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26071068
- Gay LJ et al. Dietary, lifestyle and clinicopathological factors associated with APC mutations and promoter methylation in colorectal cancers from the EPIC-Norfolk study. J Pathol. 2012 Nov;228(3):405-15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864938
- Naguib A et al. Dietary, lifestyle and clinicopathological factors associated with BRAF and K-ras mutations arising in distinct subsets of colorectal cancers in the EPIC Norfolk study. BMC Cancer. 2010 Mar 16;10:99. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233436
- Pierre F et al. Beef meat and blood sausage promote the formation of azoxymethane-induced mucin-depleted foci and aberrant crypt foci in rat colons. J Nutr. 2004 Oct;134(10):2711-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15465771
- De Mey E et al. The occurrence of N-nitrosamines, residual nitrite and biogenic amines in commercial dry fermented sausages and evaluation of their occasional relation. Meat Sci. 2014 Feb;96(2 Pt A):821-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24200576
- Parnaud G et al. Endogenous N-nitroso compounds, and their precursors, present in bacon, do not initiate or promote aberrant crypt foci in the colon of rats. Nutr Cancer. 2000;38(1):74-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11341048
- Pierre FH et al. Calcium and a-tocopherol suppress cured-meat promotion of chemically induced colon carcinogenesis in rats and reduce associated biomarkers in human volunteers. Am J Clin Nutr. 2013 Nov;98(5):1255-62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24025632
Nos conseils et astuces sur la nutrition
Filtre
Nos astuces pour un barbecue sain
Quels sont les bienfaits de l’huile d’olive ?
Produits laitiers : faut-il s’en passer pour notre santé ?